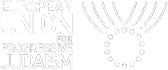B’reishit – Français
B’reshit et le courage de recommencer
de Rabbin Lea Mühlstein (traduction par Celia Naval)
« Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres….Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici: c’était très bon. » (Genèse 1:3-4, 31)
Au début de la Torah, la création se déroule non seulement de façon rythmée, mais avec un objectif clair. Dieu transforme le chaos en ordre puis s’arrête pour réfléchir : la lumière est bonne, les eaux sont bonnes, la Terre est bonne. Mais ce n’est qu’à la fin du chapitre, lorsque l’humanité est créée, que Dieu regarde l’ensemble et le désigne tov me’od (très bien).
Le plus célèbre des commentateurs juifs européens, Rashi (1040-1105) explique que c’est l’humanité elle-même qui justifie ce qualificatif final. Les êtres humains sont capables à la fois de bénédiction et de destruction, cependant c’est leur libre arbitre qui fait que la création soit complète. Pour Rashi, le monde n’est pas entièrement « très bon « jusqu’à ce qu’y figurent des êtres capables de faire des choix, d’agir et d’œuvrer en partenariat avec Dieu pour modeler la prochaine étape.
Se basant sur cette perception du temps médiéval, les penseurs juifs modernes continuent à mettre l’accent sur la responsabilité. Franz Rosenzweig (1886-1929), un des philosophes juifs allemands le plus en vue à l’époque, a enseigné dans « L’Etoile de la Rédemption » que la création n’est pas un événement abouti, mais un processus en cours. Dieu ne finit pas la création dans le récit de Genèse, elle se poursuit à chaque fois que les humains assument leur responsabilité pour le monde. Pour Rosenzweig, tov me’od se réfère à une création non aboutie qui attend notre participation afin de la compléter.
La vision de Rosenzweig, bien que distincte de l’ideologie réformée, trouvait une résonance dans l’Allemagne déjà transformée par la naissance du judaïsme réformé. Face à l’emancipation, à la pensée des lumières et les bouleversements de l’Europe moderne, des pionniers tels que Abraham Geiger (1810-1874) et Samuel Holdheim (1806-1860), ont étudié la pratique juive dont ils étaient les héritiers et ils ont posé une question parallèle : ici qu’est-ce qui relève de la lumière? Qu’est-ce qui peut être jugé bon?
Les premiers pionniers du judaisme reformé ont vu la pratique juive hérité plutôt comme nous lisons les premiers versets de la Genèse : un tourbillon de lumière et d’ombre, d’opportunités et de contraintes. Ils ont cherché à mettre de l’ordre dans ce vaste héritage, mettant en relief ce qui portait une puissance morale durable et écartant des pratiques qui obscurcissaient l’essence éthique et prophétique du judaïsme. A travers leurs sermons, leurs livres de prière et leurs institutions, ils insistaient que le judaïsme pouvait se renouveler. Le renouveau ne serait pas atteint en laissant de côté le passé, mais en mettant en évidence ses meilleures vérités et en les déclarant « très bonnes « pour une nouvelle ère.
Le théologien du judaïsme reformé américain, Eugene Borowitz (1924-2016) a par la suite donné voix à cette impulsion en terme d’alliance. Pour lui, dans la notion d’alliance, il ne s’agissait pas uniquement d’obéissance mais aussi de dialogue.L’invitation de Dieu à Israël est incomplète sans la réponse des humains. La bonté divine ne prend corps que lorsque les hommes lui donnent vie à travers leurs choix. Puisant dans l’héritage intellectuel laissé par les pionniers du judaïsme réformé allemand, Borowitz fait écho à la fois à Rashi et à Rosenzweig: la bonté portée par la création et la bonté portée par le judaïsme se réalisent à travers le partenariat.
Recommencer n’est jamais chose aisée. Plus de 100 ans après le décès des premiers pionniers du judaïsme réformé, une nouvelle génération de pionniers, dont mon père, se sont donné comme mission la résurrection de la vie juive réformée en Allemagne après la Shoah. Tout comme pour les premiers pionniers Reform, leur audace se trouvait dans leur acceptation de juger, affirmer et croire qu’un judaïsme réformé pourrait être accueilli comme tov me’od. Ils étaient des modèles par leur courage de non seulement préserver mais également de créer, agissant en partenaires de Dieu dans la formulation d’un avenir juif pour leurs enfants et petits-enfants. Ils ont établi un mouvement de judaïsme réformé moderne et vibrant pour l’Allemagne du 21ème siècle.
De nos jours nous voyons que le courage s’étend bien au-delà du judaïsme réformé. La philosophe contemporaine israélienne orthodoxe Tamar Ross (née 1938) a été profondément influencée par cette idée de création et révélation en évolution. Dans son ouvrage « Élargir le Palais de la Torah », Ross argumente que la révélation est cumulative : chaque génération augmente la portée de la Torah en y ajoutant de nouvelles voix et compréhensions. Ce qui fut radical dans l’Allemagne du 19ème siècle fait partie maintenant de la pensée juive courante : l’acceptation que l’alliance de Dieu n’est pas figée dans le passé mais prend forme à travers la participation humaine.
Placée à côté de B’reishit, le message de Ross est frappant. Dieu déclare la création très bonne non pas parce qu’elle est terminée mais parce qu’elle nous a été confiée. Le rôle des humains dans chaque génération est d’élargir la promesse de la création, de recommencer pour nos jours.
Alors, au moment où nous revenons à B’reishit cette année, quelle lumière devons-nous nommer ? Où devons-nous séparer l’obscurité de la bonté dans la vie juive et dans le monde? Comment allons-nous attester de ce qui est tov me’od pour nos communautés maintenant ?
Le premier chapitre de la Torah n’est pas uniquement un rappel de la création du monde; c’est également un devoir pour chaque génération. Considérer la création comme très bonne implique d’assumer le courage du partenariat. Le judaïsme réformé est né de ce courage en Allemagne il y a presque deux siècles. Il nous incombe de le porter en avant : de créer, de discerner et de recommencer afin que, de nos jours, le monde puisse être jugé tov me’od – très bon.