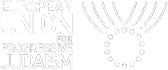Tol’dot – Français
Si oui, pourquoi est-ce que j’existe ? Le courage de vivre dans la pluralité.
de Rabbin Lea Mühlstein (traduction par Celia Naval)
Les enfants se heurtaient dans son sein; et elle dit: « S’il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l’Eternel. Et l’Eternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. (Genèse 25:22-23)
L’interrogation de Rebecca transperce le texte. « Si oui, pourquoi est-ce que j’existe? » Son corps devient le lieu d’une contradiction divine. Deux nations l’habitent, deux avenirs sont en lutte dans son ventre. L’image évoquée dans la Torah est souvent lue comme une prophétie de conflit inévitable, mais on peut la lire aussi – comme enseigne la théologienne féministe juive Judith Plaskow, comme une révélation de pluralité.
Dans son essai ‘ La théologie juive d’une perspective féministe’, Judith Plaskow écrit que la théologie féministe « est enracinée dans une expérience plus large et plus riche de comment être, qui cherche à s’exprimer à l’intérieur et à l’encontre de la terminologie de la tradition. Au fil de son œuvre, Plaskow argumente que la révélation n’est pas quelque chose donnée de manière fixe, mais un travail continu et partagé qui s’agrandit en intégrant des voix jusque là interdites d’expression et en tenant des tensions créatrices. Ce qui perturbe Rebecca devient alors non pas une malédiction mais une vocation. En elle, coexistent des vérités qui se contestent; elle est porteuse d’une alliance qui comprend la tension.
Vue dans cette perspective, la grossesse de Rebecca est une métaphore théologique pour l’existence juive dans des sociétés qui demandent une adhésion unique. Son interrogation : “Si oui, alors pourquoi est-ce que j’existe ? » est le cri de chaque communauté pris entre la foi et la nation, entre la tradition et la modernité.
Ce tiraillement s’est manifesté de la manière la plus aiguë en France , le berceau de l’émancipation juive et, plus tard, d’une conformité institutionnelle. Lorsque Napoléon convoqua le Grand Sanhédrin en 1807, il avait comme objectif d’intégrer les juifs comme loyaux citoyens français tout en les contraignant à redéfinir leur foi dans le cadre de la logique de l’état. La tâche devant laquelle se trouvait le Sanhédrin était de répondre à 12 questions visant à prouver que le judaïsme était compatible avec le Code Napoléon : est-ce que des juifs épouseraient des non-juifs, est-ce qu’ils placeraient les lois de la nation au-dessus de la halakha, est-ce qu’ils serviraient dans l’armée?
Bien que les questions posées par Napoléon ne le furent pas forcément de bonne foi, la communauté juive accepta volontiers le projet napoléonien visant à réconcilier deux nations en un ensemble : la République Française et le peuple juif. Cependant, l’intégration proposée l’était au prix de l’autonomie. De cette démarche surgit le système consistorial, une structure centralisée conçue pour placer la vie religieuse juive sous surveillance de l’État.
Un siècle plus tard, le Rabbin Louis Germain Lévy (1866-1946), un des fondateurs de l’Union Libérale Israélite de Paris (ULIP) en 1907, contesta cet héritage. Erudit respecté et rabbin de la synagogue de la Rue Copernic, Lévy chercha à affirmer à la fois l’identité française et l’indépendance spirituelle juive. Il accueilla l’universalisme de la République, tout en résistant au monopole consistorial. Comme les jumeaux de Rebecca, ces deux pulsions luttaient au sein du même corps.
Les sermons et écrits de Lévy révèlent sa quête d’interpréter le judaïsme comme une foi morale et rationnelle compatible avec les valeurs civiles françaises mais pas comme quelque chose qui pouvait s’y réduire. Il était d’avis que la vitalité du judaïsme nécessitait la liberté de pensée et une réforme du rituel. L’Union Libérale offrait un foyer pour des juifs qui se sentaient français par l’esprit mais qui languissaient un judaïsme ouvert à la modernité, à l’égalité et à l’honnêteté intellectuelle. En ce sens, Lévy mit en œuvre la vision de Plaskow de la révélation comme dialogue : une expression renouvelée de la tradition dans le langage de son époque.
Cependant, comme dans le ventre de Rebecca, la relation entre les deux nations est restée tendue. Le Consistoire accusa les juifs libéraux de trahison ; les juifs libéraux accusèrent le Consistoire de stagner. Chacun déclara porter le vrai héritage. En France comme dans la Genèse, la question n’était pas seulement de savoir qui allait contrôler le pouvoir, mais comment les deux puissent coexister sans s’annihiler mutuellement.
La théologie de Plaskow nous invite à lire cela non comme une tragédie de la division, mais comme un signe de vie. Une foi qui peut détenir des vérités opposées, est une foi toujours vivante. L’histoire juive française, comme celle de Rebecca, n’est pas celle du triomphe d’une sur l’autre; au contraire, elle raconte comment des devoirs à la fois civiques et émanant de l’alliance religieuse perdurent en une seule identité.
Aujourd’hui, les communautés juives libérales, regroupées au sein de Judaïsme en Mouvement et de La Fédération du Judaïsme Libéral forment un pont entre la tradition et la modernité, entre ce qui distingue le judaïsme et l’éthique universelle. Leur engagement en faveur de l’égalité des genres, du dialogue inter-religieux et des valeurs républicaines sont le reflet d’une identité qui refuse la singularité.
Le récit de Tol’dot nous invite à nous interroger sur ce que nous faisons des tensions qui nous habitent. Est-ce que nous les voyons comme des menaces à l’unité ou comme des affirmations d’une alliance vivante? Dans la lutte de Rebecca et la négociation de la France entre la foi et la citoyenneté, nous entrevoyons que la contradiction n’est pas un défaut ; c’est une condition de vitalité.
Vivre en tant que juifs libéraux implique d’accepter cette complexité – savoir que la foi, l’identité et l’appartenance nous tirailleront toujours dans plus d’une direction. Notre tâche n’est pas de résoudre ces tensions, mais de les habiter avec intégrité. Comme Rebecca et les pionniers du judaïsme libéral français, nous affirmons que la bénédiction divine se trouve dans le courage de vivre honnêtement dans la multiplicité.